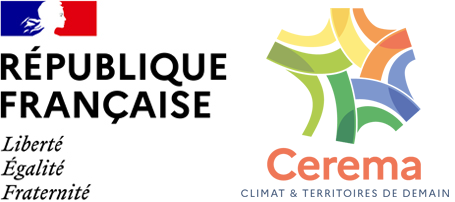L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
Les AVAP sont d’anciens outils de protection et de mise en valeur du patrimoine. Elles ont depuis été transformées en sites patrimoniaux remarquables (SPR).

L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) est un ancien outil de mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces patrimoniaux. Elle avait été créée pour succéder à la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), avant que le site patrimonial remarquable (SPR) ne lui succède à son tour.
L’AVAP permettait notamment de fixer des règles relatives :
- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes, et à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
- à l’intégration architecturale et l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.
Comme la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysagers (ZPPAUP) à laquelle elle a succédé, l’AVAP avait le caractère de servitude d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation des sols.
A noter : Les AVAP créés avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) sont devenues de plein droit des sites patrimoniaux remarquables (SPR) .
Principaux textes de référence
Voir les anciennes versions des articles L.642-1 à L.642-10 et D. 642-1 à D. 642-29 du code du patrimoine.
Attention : les liens ci-dessus ne correspondent pas à la version à jour des articles précités du code du patrimoine mais à la version de ces articles avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (avant que les sites patrimoniaux remarquables succèdent aux AVAP).
Sarah Olei - Cerema